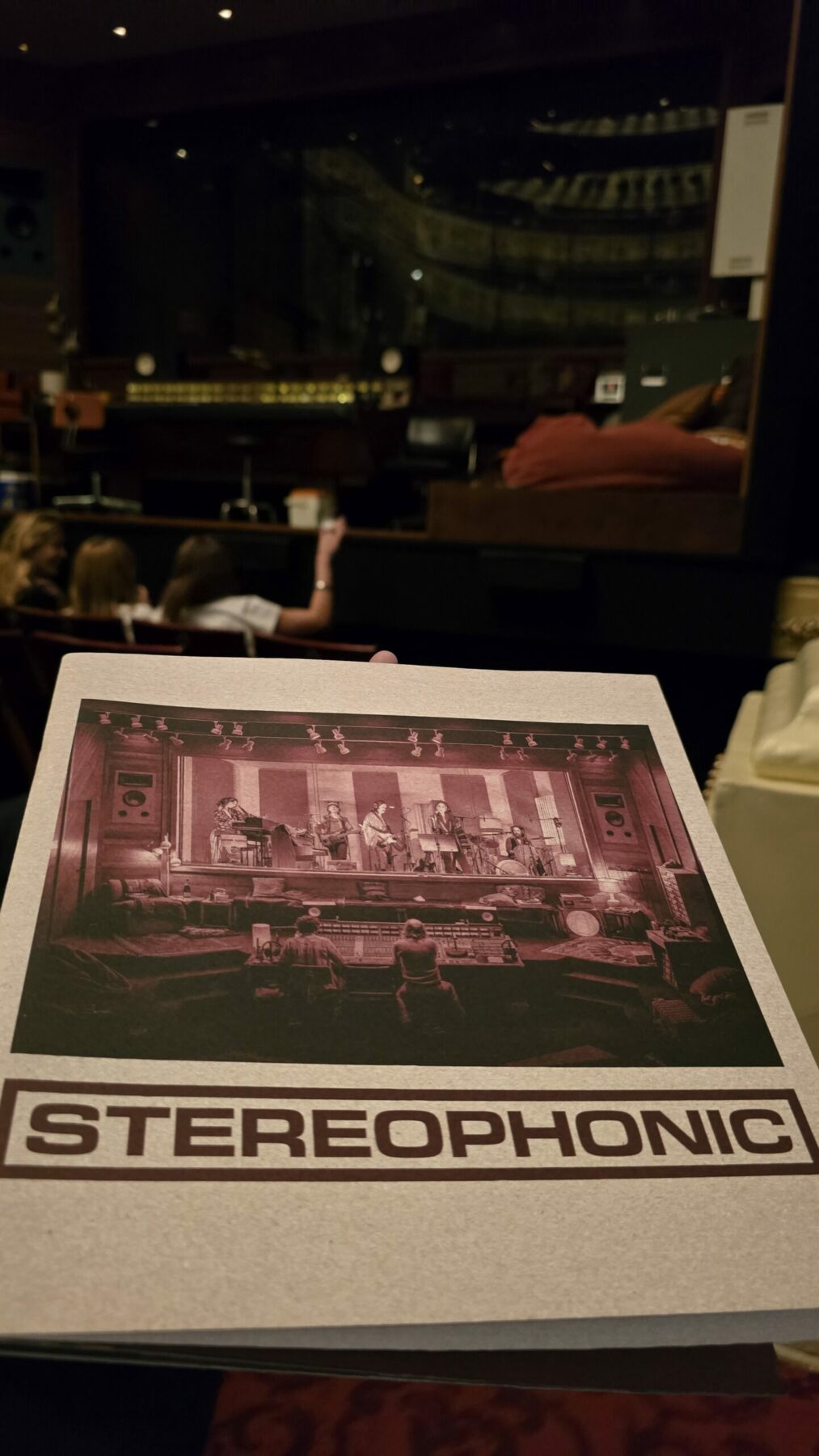← Retour au voyage : Londres octobre ’25
🎶 « Stereophonic » (Duke of York’s Theatre)

Il va falloir faire fort après ce choc théâtral que j’ai eu cet après-midi. Je ne prends pas un vrai risque puisque que ce spectacle a remporté cinq Tony Awards dont celui de la meilleur pièce (ayant reçu 12 nominations, ce qui est le record absolu pour une pièce de théâtre). J’ai employé le terme « spectacle » car ce n’est pas une pièce de théâtre. Ni un musical. Du théâtre musical alors? Non pas au sens habituel. Il s’agit en fait d’un véritable OVNI théatralo-musical, à la fois radicalement réaliste et profondément poétique. C’est en effet une création hors catégorie, une sorte de théâtre immersif du son (ceux qui trouvaient qu’à Bruxellons! le son de Rebecca était trop fort peuvent venir s’immerger dans celui de Stereophonic), où la musique existe comme un personnage invisible.
En fait le pitch du spectacle est très simple: dans un studio californien des années ’70, un groupe de rock enregistre l’album qui fera sa légende. Au fil des jours, la tension monte, les couples se brisent, les égos explosent. Tandis que la musique prend forme, le groupe se désintègre. La question est claire: la création collective débouche-t-elle sur la loi de la jungle, sur la destruction du collectif et la prise de pouvoir de l’ego? La réponse du spectacle est clairement OUI.

Moi qui suis un fan des musicals – et un détracteur absolu de la pseudo comédie musicale à la française – je suis désarçonné – mais avec éblouissement – par cet OVNI qui n’a rien d’un musical: pas de numéros chantés face public, pas de partition dramatique continue, pas de chorégraphie, pas même de chanson complète jouée jusqu’au bout (enfin si, une seule). Et pourtant, la musique y est le moteur dramatique absolu. Tout tourne autour d’elle : les rapports de force, les désirs, les ruptures. Elle est présente sans être « représentée », sans être mise en scène – un peu comme une divinité muette autour de laquelle les humains tournent et font de nombreux sacrifices. C’est un musical fantôme: on n’y chante presque pas, mais on n’y parle que de musique. David Adjami (auteur) et Will Butler (compositeur des chansons originales) ont inventé ainsi un genre hybride où la musique est une tension, pas un résultat.

La scénographie est un dispositif théâtral unique: un studio d’enregistrement des années ’70 hyperréaliste (microphones, consoles, vitres, amplis, …). On ne s’en rend pas compte en entrant dans la salle. Mais il y a en fait deux espaces de jeu: le studio d’enregistrement proprement dit, derrière la vitre et la zone commune, où travaillent les deux ingénieurs du son. Cette séparation en deux n’est pas un simple choix esthétique mais on va très vite se rendre compte que c’est le principe dramaturgique même de la pièce.
Il faut aussi signaler que la pièce se déroule au milieu des années ’70, une époque où les jeunes consommaient de la marijuana et ce la cocaïne comme celle d’aujourd’hui mange des légumes bios.
Même si nous somme en Californie, nous allons suivre l’enregistrement du nouvel album d’un groupe de rock britannique (jamais nommé, mais selon l’auteur, il faut penser à Fleetwood Mac) après le succès retentissant de leu disque précédent. Ils veulent faire mieux, plus grand, plus pur — atteindre le son parfait.
Au début, l’énergie est euphorique. Les musiciens débattent, rient, improvisent, s’aiment et se chamaillent. Il y a Peter, le guitariste et compositeur principal qui pousse les autres à bout par son obsession du détail. De son côté, Diana, la chanteuse (et « ancienne » compagne de Peter), revendique une approche plus instinctive. Reg, le bassiste, est sous la perpétuelle emprise – et c’est un faible mot – de la drogue. Holly, la claviériste, a de la compassion pour l’état de Reg, avec qui elle a une relation … à géométrie variable. Il y a encore le percussionniste Simon. Mais il y a aussi l’ingénieur du son, Grover, dont c’est le premier enregistrement majeur, et son collègue Charlie.
Il faut souligner qu’il n’y a aucune histoire racontée si ce n’est « l’enregistrement d’un disque ». On vit des tentatives d’enregistrement de différentes chansons – parfois dix prises de quelques phrases musicales. Puis les artistes viennent écouter le résultat pour validation de l’enregistrement. Ça discute, ça se dispute, ça se réconcilie, …
Cela parait bizarre, mais petit à petit, on se rend compte qu’il y a en fait un autre personnage: la musique. Les tensions montent à mesure que les chansons prennent forme. Ce premier acte, plein de vitalité, montre la naissance d’un chef-d’œuvre dans le chaos.
Soulignons déjà qu’à ce stade que la scénographie en deux zones est magnifiquement au service du message. La zone avant, celle de la régie, est une zone d’analyse, de contrôle, de discussions. C’est la zone des individualités, des caractères, des égoïsmes. Et puis, il y a la cabine à l’arrière où les artistes sont au service du personnage principal, la musique.

L’ingéniosité du scénographe David Zinn tient à cette séparation transparente, la vitre: le public voit les deux espaces simultanément, mais les entend différemment. D’ailleurs, Grover, l’ingénieur du son avec un seul curseur peut isoler les deux zones. Parfois, on n’entend pas les artistes dans le studio alors que les ingés-son discutent. Parfois on entend les deux zones qui se téléscopent. Cette frontière de verre crée une tension visuelle (on voit sans toujours entendre). La vitre, centrale dans le décor, devient un symbole dramaturgique de la communication impossible (on se voit sans se comprendre) .
Et attention, une fois encore, ce n’est pas un musical: on n’a pas entendu une seule chanson en entier. Nous voici donc à la fin de l’acte I, et donc près de 1h30 de spectacle. Et déjà on en redemande.
Le deuxième acte se situe quelques mois plus tard… et tout a changé: la fatigue, les nuits blanches, la drogue et les rivalités ont usé le groupe. Les couples se défont: Peter et Diana ne se parlent plus, Simon et Holly se séparent, Reg se replie dans le silence (et les univers artificiels). L’ingénieur du son, Grover, tente d’éviter l’implosion, témoin impuissant de cette désintégration. Pourtant, au cœur de la crise, une chanson naît – fragile, lumineuse. C’est le miracle de la création: la beauté jaillit au moment même où tout s’effondre.

Ici encore la division en deux zones est fondamentale car ce deuxième acte est rude. Il n’y a que dans le studio que le groupe existe, que le jeu de la solidarité existe. En dehors, c’est la foire d’empoigne. Une passionnante heure plus tard, l’album est enfin terminé. Place à l’épilogue.

Les musiciens écoutent la bande finale en silence. Seule la musique existe encore. Tous, ils savent que le résultat est exceptionnel … mais que le groupe ne survivra pas à cet exploit. C’est le feu d’artifice final, un des temps forts du spectacle – l’émotion y devient visible même dans le silence entourant l’écoute. L’un après l’autre, ils quittent le studio, laissant Grover seul. Il remet la bande, écoute un dernier souffle de voix, puis coupe le son.
Noir.
Le disque est né, mais le groupe est mort.
Applaudissements…

Stereophonic n’est pas une pièce « sur le rock »: c’est une tragédie sur la création collective. Elle montre comment le travail artistique, en cherchant la perfection, consume ceux qui le portent. À travers une écriture ultra-réaliste, presque documentaire, Adjmi fait du studio un temple où se rejoue le mythe éternel de l’art: créer, c’est perdre quelque chose de soi. Le spectacle explore la frontière entre la beauté et la destruction, le génie et l’épuisement, l’union et la solitude. C’est à la fois un hommage au processus artistique et une méditation sur le prix du chef-d’œuvre.
En fait ce que j’ai adoré dans ce spectacle, c’est que David Adjmi fasse entendre ce que le théâtre capte rarement: la création en train de détruire une équipe tout en aboutissant artistiquement. Même si c’est très difficile à expliquer, les bruits (cliquetis de bande, feedback, grésillement) deviennent les ponctuations du texte. C’est la seule pièce – que je connaisse – à avoir fait du son et non du texte ou du corps – son vecteur principal.
On participe vraiment à cette création. A sa réussite artistique et à son naufrage humain.

Que dire d’autre? Que c’est magnifiquement joué, que la musique – même distillée en embryons – est très belle. Que c’est un vrai bonheur que de plonger, non d’être immergé, dans les années ’70. Soulignons encore que chaque artiste joue de son propre instrument, et cela rajoute encore à l’authenticité.
Derrière la réussite artistique, Stereophonic met en scène une désintégration intime: à mesure que la musique se rapproche de la perfection, le groupe se défait. Le chef-d’œuvre qu’ils créent devient une œuvre orpheline, fruit d’une communauté qui n’existe déjà plus. Quand la musique triomphe, les liens humains s’effondrent. L’art demeure – mais ceux qui l’ont façonné ne peuvent plus vivre ensemble.
D’ailleurs, mêmes si tous les individus ont un prénom, le nom du groupe de rock lui n’est jamais nommé. En fait, il n’a pas d’âme. Seule la musique est la en guise de témoignage.
Dur, dur. Mais tellement vrai. Il suffit de regarder l’explosion de certains des groupes les plus célèbres. Dont bien sûr les Beatles. Mais ils ne sont pas une exception.
Quel bel OVNI.