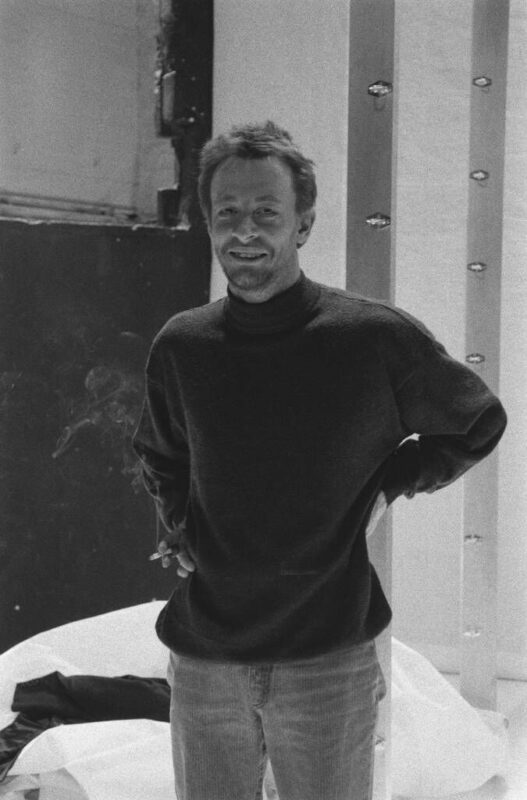← Retour au voyage : Londres octobre ’25
🎭 « The Lady from the Sea » (Bridge Theatre)

Mais d’abord, chaque fois que je vois une pièce d’Ibsen, je pense à ma première confrontation avec lui. C’était en 1984 au Théâtre National de Belgique – il s’appelait encore comme cela à l’époque. Jacques Husiman avait mis en scène Maison de poupée avec Patricia Houyoux dans le rôle de Nora et Michel de Warzée dans le rôle de son mari Helmer. Un choc. J’ai vu deux des 49 représentations à Bruxelles (on faisait encore des séries au National à l’époque).
J’ai aussi vu Hedda Gabler mis en scène par Roumen Tchakarov au Parc en 1995 avec Houyoux et Frison.
Hedda Gabler – Photos Serge Daems
Puis Un Ennemi du Peuple mis en scène par Lorent Wanson, à nouveau au National avec René Hainaux…
Et enfin l’Hedda Gabler mis en scène par Sireuil au Vilar en 2002. Depuis plus rien… Et j’ai raté La Dame de la Mer mise en scène par Michael Delaunoy aux Martyrs en février 2022.
Mis je me souviens d’une longue discussion avec Pierre Laroche qui trouvait qu’Ibsen poussait ses personnages à se révéler à eux-mêmes et à réagir, ce que ne faisaient pas les auteurs russes, qui étaient plus des poètes du non-dit. D’où son amour pour les auteurs russes.
Il est vrai qu’Ibsen a été une révolution quand ses pièces ont été créées à la fin du XIXème siècle en Europe occidentale. Le programme du Bridge Theatre nous le rappelle clairement. L’introduction d’Henrik Ibsen en Europe occidentale – et surtout en Angleterre à la fin du XIXème siècle – a provoqué un véritable séisme culturel et moral. On pourrait presque dire que c’est le moment où le théâtre victorien a perdu son innocence.
Lorsque les premières pièces d’Ibsen – Une maison de poupée (1879), Les Revenants (1881), Hedda Gabler (1890) – ont été traduites et jouées dans les années 1880-1890, le public anglais, encore très marqué par les conventions morales victoriennes, fut profondément choqué. On y voyait une attaque frontale contre la famille, la religion, et l’ordre social – les piliers de l’Angleterre victorienne. Jusqu’alors, le théâtre anglais vivait surtout de pièces bien ficelées et de mélodrames moralisateurs.
Ibsen apporta tout autre chose. Il a osé développer un réalisme psychologique sans concession et créer une structure dramatique ne débouchant pas sur un sans « happy end ». En outre, ses personnages sont souvent gris: ni bons ni méchants. On est loin de tout manichéisme. Enfin, il s’attaque à des questions sociales et existentielles: le mariage, la liberté, l’hypocrisie bourgeoise….
Pour la critique traditionnelle, c’était de l’anti-théâtre: pas de héros, pas de catharsis, juste une autopsie morale. Mais pour les jeunes intellectuels, c’était une révélation. George Bernard Shaw, par exemple, adore Ibsen à propos duquel il écrit avec humour et provocation: « La plupart des gens vivent des mensonges et appellent cela morale. Ibsen les force à se regarder dans la glace, et ils appellent cela immoral. »
Très vite, les milieux progressistes et intellectuels vont s’emparer de son œuvre. Des figures comme George Bernard Shaw, William Archer (traducteur et défenseur d’Ibsen) ou Harley Granville Barker virent en lui le modèle d’un théâtre moderne: un art capable de discuter la morale, la politique, la condition féminine, la vérité. Shaw lui consacra même un essai célèbre: The Quintessence of Ibsenism (1891), où il défend l’idée qu’Ibsen met à nu les hypocrisies sociales et qu’il faut l’aimer pour cela.
L’impact fut encore plus fort sur le plan du féminisme naissant. Nora Helmer, l’héroïne de Une maison de poupée, allait créer une vraie rupture et un scandale. Le scandale ne venait pas seulement du fait qu’elle quitte son mari mais qu’elle abandonne aussi ses enfants pour «devenir elle-même». Un critique a écrit: « Une mère qui abandonne son foyer n’est pas une femme, c’est un monstre moral. » Le scandale fut tel qu’en Allemagne, l’actrice Hedwig Niemann-Raabe, qui devait jouer Nora, refusa de jouer la fin: « Je ne peux pas abandonner mes enfants sur scène! » Ibsen dut alors écrire une « fin de compromis » (qu’il détestait): Nora regarde ses enfants endormis, s’effondre en larmes, et décide de rester. Ibsen dira plus tard que cette fin était une « barbarie » imposée par les producteurs. Heureusement, elle fut vite abandonnée après quelques représentations.
Nora devint un symbole de l’émancipation féminine. À l’époque, sa décision finale inspira des générations d’artistes et de militantes. Ibsen ne s’attaque pas au mariage comme union entre deux êtres aimants, mais bien au mariage comme institution sociale, c’est-à-dire comme contrat imposé, prison morale et miroir de l’hypocrisie bourgeoise. Ibsen démonte la structure du mariage victorien: le mari détient le pouvoir légal, financier et moral, tandis que la femme dépend entièrement de lui. Attention, Ibsen ne rejette pas l’amour, bien au contraire. Mais il refuse qu’il soit enfermé dans les conventions du mariage légal ou religieux. Ses héroïnes cherchent l’intégrité personnelle avant la fidélité sociale. L’amour ne peut exister, selon lui, que dans la liberté et l’égalité.
Ce qui choqua le public victorien, c’est que ces femmes osent partir. La fuite de Nora à la fin de Une maison de poupée fut jugée monstrueuse. Mais pour Ibsen, ce geste n’est pas égoïste: c’est un acte moral supérieur, celui de quelqu’un qui refuse de vivre dans le mensonge. « J’ai d’abord un devoir envers moi-même » affirme Nora à la fin de Une maison de poupée. Cette phrase, en 1879, fit trembler toute l’Europe.
En ce qui concerne La Dame de la Mer, Ibsen change un peu d’angle de lecture. C’est une pièce d’une poésie étrange et symbolique, un peu plus rêveuse que ses drames réalistes précédents (Une maison de poupée, Les Revenants, Un Ennemi du peuple), mais qui poursuit la même critique du mariage et de la liberté individuelle, sous une forme plus symbolique. Pour comprendre la différence entre Nora (Maison de Poupée) et Ellida (Dame de la Mer) attardons nous au synopsis de la pèce.
La pièce s’ouvre dans la maison du docteur Wangel, un homme bon et rationnel, veuf d’un premier mariage. Le cadre est paisible, mais Ellida, sa femme, semble étrangère à cette sérénité.
Elle est l’ancienne fille d’un gardien de phare, rêveuse et mélancolique. Elle passe ses journées à contempler la mer, obsédée par un passé qu’elle tait. Wangel s’inquiète pour elle, craignant qu’elle ne sombre dans la mélancolie. Vivent avec le couple les deux filles (des adolescentes) de Wangel, issue d’un premier mariage.
Il est important de souligner à ce stade quelque chose de fondamental: dans une société où le mari est censé « tenir la barre du foyer », Wangel fait tout l’inverse: il observe, écoute et respecte la complexité intérieure de sa femme. Il ne cherche pas à imposer sa volonté, mais à comprendre ce qu’il ne comprend pas. Là où beaucoup d’hommes d’Ibsen (Helmer dans Une maison de poupée en est l’exemple typique) sont prisonniers de la morale et de l’apparence, Wangel agit en être humain, non en patriarche. Revenons au synopsis…
Arnholm, ancien précepteur de la famille, revient en visite. Il retrouve Bolette, qu’il a aimée jadis, et découvre la distance étrange entre Ellida et son mari. Peu à peu, Ellida confie à Arnholm le secret qui la ronge: des années plus tôt, avant son mariage, elle a été fiancée à un marin inconnu, un homme libre, presque sauvage. Lorsqu’il est partit, ils ont scellé leur promesse en lançant dans la mer deux anneaux enlacés:
« Nous avons échangé nos anneaux, et nous les avons jetés ensemble dans la mer. Nous avons juré que, s’il m’appelait, je viendrais à lui. (…) Il disait que, puisque la mer nous liait, nous devrions nous appartenir toujours – tant que nous vivrions. »
Depuis, elle vit à la fois dans la peur et le désir de son retour. Un jour, l’Étranger revient réellement.
Il surgit au bord de la mer, calme et déterminé, et réclame à Ellida qu’elle le suive: « Je suis revenu, comme je te l’avais dit. Es-tu prête? » Ellida est bouleversée. L’Étranger exerce sur elle une fascination quasi surnaturelle, mi-érotique, mi-hypnotique.
Wangel, désemparé, comprend que ni la raison ni la morale ne peuvent lutter contre cet appel.
Ellida avoue qu’elle aime son mari, mais qu’elle ne peut se sentir lui « appartenir exclusivement ». Wangel, dans un geste d’une grandeur rare, lui rend sa liberté: « Tu es libre, Ellida. Si tu veux partir avec lui, je ne t’en empêcherai pas »
Ce que j’ai envie d’appeler un « don de liberté » bouleverse Ellida. C’est la première fois qu’on la traite comme une femme libre et non comme une possession. C’est alors qu’elle trouve en elle-même la force de choisir – et elle choisit de rester. C’est une énorme différence avec Nora, bien entendu.
L’Étranger part. Ellida se tourne vers Wangel, son mari, et lui dit :
ELLIDA(regardant au dehors, apaisée) – Wangel… maintenant, je sens… que je peux rester. Non par devoir — mais par choix.
WANGEL(ému) – Et moi… je sens que je t’ai vraiment gagnée. Toi, et ta mer.
FIN
Le couple se réconcilie. La fin est à la fois douce et symbolique: l’amour devient possible seulement quand il s’affranchit de la contrainte. En choisissant de rester par choix, non par obligation, Ellida devient une sorte d' »héroïne moderne »: la femme qui s’appartient enfin.
Mais attention, ça c’est la pièce originale d’Ibsen. La version présentée au Bridge Theatre est une adaptation de Simon Stone.
Simon Stone est l’un des jeunes (40 ans) metteurs en scène très important, connu pour sa façon radicale de revisiter les grands textes du répertoire. Il se fait remarquer par des réécritures audacieuses de Tchekhov, Ibsen, Wedekind ou Lorca, où il dépouille les pièces de leur décor d’époque pour les replacer dans un univers contemporain.
Stone ne met pas en scène les classiques: il les réécrit. Il conserve la structure émotionnelle et les thèmes essentiels, mais transpose tout le reste: le langage devient celui d’aujourd’hui, direct, cru, souvent familier. Dans The Lady of the Sea au Bridge, les deux filles parlent de leur publications sur les réseaux sociaux. De même, les situations sont déplacées dans un contexte moderne (ville, banlieue, famille recomposée, etc.). Enfin, les rapports de pouvoir et les questions sociales sont actualisés (sexisme, santé mentale, crise de sens…). Pour lui, le texte classique est un matériau vivant, à repenser pour le public du présent. Ses adaptations creusent les mêmes blessures humaines – amour, solitude, vérité – mais dans un langage et un décor d’aujourd’hui.
Et en dehors de cette magnifique modernisation – vraiment magnifique car on a l’impression d’assister à une création contemporaine – Simon Stone au Bridge Theatre a décidé de réécrire le sens même de la fin, de manière plus dure, plus ambivalente – et beaucoup moins « réconciliatrice » que celle d’Ibsen. Dans cette version, Ellida ne « choisit » pas vraiment de rester ou de partir: la frontière entre les deux s’efface. Ellida ne se positionne pas. Elle est incapable de prononcer la phrase de la pièce originale: « Maintenant je peux rester, car je reste de mon plein gré. » On comprend qu’elle est incapable, en tout cas à cet instant précis, de revenir à une vie normale. Elle a besoin de temps… Ellida, valise à la main, s’en va sans que l’on sache si elle reviendra – à la manière de l’Ellida originale – ou si elle partira définitivement – à la manière de Nora dans Une maison de poupée. Cette fin renforce encore la quête de liberté d’Ellida. Dans cette adaptation, Ellida a sa propre volonté et prend ses décisions quoi que puisse en penser son mari, même si ce dernier est bon et rationnel.
Pour être tout à fait complet, Stone a ajouté dans sa réécriture des couches de traumatismes passés, comme la culpabilité d’Ellida concernant la mort d’un garde de sécurité pour laquelle son ancien amant a été emprisonné à sa place. Cela complexifie le personnage et ses raisons de partir pour réfléchir, pour faire le point.
Magistral…
Comme le laissent paraître les photos ci-dessus, la scénographie joue un rôle majeur dans la dramaturgie. Il y a une évolution visuelle du blanc vers le noir dans la mise en scène de Simon Stone qui n’est pas qu’un effet esthétique: elle accompagne le trajet intérieur d’Ellida et, par ricochet, celui de Wangel et de tout le couple. C’est une signature de Stone: il fait parler l’espace scénique comme un personnage à part entière.
Comme le laissent paraître les photos ci-dessus, la scénographie joue un rôle majeur dans la dramaturgie. Il y a une évolution visuelle du blanc vers le noir dans la mise en scène de Simon Stone qui n’est pas qu’un effet esthétique: elle accompagne le trajet intérieur d’Ellida et, par ricochet, celui de Wangel et de tout le couple. C’est une signature de Stone: il fait parler l’espace scénique comme un personnage à part entière.
Phase 1 : tout en blanc
Au début du spectacle, la scénographie (signée Lizzie Clachan) plonge les spectateurs dans un décor très lumineux, presque clinique: sol blanc et mobilier blanc épuré. Tout respire l’ordre, la pureté, la transparence. Mais ce blanc est trompeur. Très vite, le spectateur comprend que c’est la blancheur d’une maison où tout est refoulé: les émotions, le passé, le désir, la peur de la perte. Le blanc devient la couleur de la façade bourgeoise – propre, apaisée, mais glaciale.
L’entracte survient assez tôt dans le déroulement de la pièce. Et durant cet entracte voici à quoi l’on peut assister si on ne va pas acheter à boire ou des friandises.
Phase 2 : noir et pluie intense
La transition vers la deuxième partie de la pièce est un changement radical avec le décor qui devient entièrement noir, et cette pluie torrentielle qui s’abat sur la scène. S’abattre est vraiment le bon terme. En tant que spectateur c’est physiquement très intense, même s’il ne nous pleut pas dessus. Le passage du blanc au noir symbolise l’émergence des secrets enfouis et des émotions refoulées. Mais la pluie nous fait ressentir la tempête émotionnelle que vit Ellida. La pluie est une manifestation physique explosive du tumulte et du désordre psychologiques qu’elle a longtemps essayé de contenir.
Cette phase voit les confrontations les plus intenses de la pièce, où les masques tombent. La métamorphose du décor reflète le déferlement des passions sombres, et les personnages sont littéralement arrosés par leurs propres vérités.
Une présence vitale dans tout cela est Heath (Joe Alwyn), qui est venu pour un diagnostic auprès de son cousin éloigné, le neurologue Edward Wangel. Heath est le genre d’homme qui prouve qu’il est intelligent en citant de la poésie et de la littérature obscure, ce qui est drôle mais aussi grinçant, et ses mauvaises nouvelles (il est atteint de SLA – Sclérose latérale amyotrophique) – et il lui reste six mois au mieux à vivre). C’est le seul qui semble serein sous la pluie. il sait que pour lui … c’est bientôt fini.
Phase 3 : la pataugeoire
Après le déluge de la pluie, le niveau d’eau sur scène monte et se transforme en une pataugeoire, dans laquelle les personnages évoluent.
Les personnages sont à ce stade submergés sous le poids de leurs émotions et de leurs traumatismes. Ils sont forcés d’interagir dans un espace où ils ne peuvent plus maintenir leur façade. Il y a une terrible scène où Edward Wangel discute avec Lyle (ancien amant d’Ellida et un ami proche d’Edward) chacun sur les bords de la pataugeoire. Entre eux, dans la pataugeoire, Finn (l’étranger) et Ellida son couché l’un sur l’autre dans l’eau et … « flirtent ». Cette scène est à la fois intense et sensuelle, suggérant un retour aux désirs primaires. Elle interfère évidemment dans nos esprits avec la discussion Entre Edward et Lyle sur les bords. Cette double image est terrifiante.
Phase 4 : la piscine
À la fin, la scène se transforme en une véritable piscine. Cette piscine marque le point culminant de la libération d’Ellida. L’eau devient un espace de liberté en contraste total avec la pataugeoire où les personnages étaient coincés, touchant le fond, n’étant pas libre de leurs mouvements. Si l’eau symbolisait d’abord le danger, elle se transforme ici en un lieu de possible libération pour Ellida, qui, en s’y plongeant, affirme son choix et sa liberté retrouvée, même si ce choix est de partir.
J’en retiens particulièrement une scène où Heath nage seul et silencieusement dans la piscine. On pourrait dire qu’il fait des longueurs. On est en contraste total avec les drames bruyants et les affrontements qui ont lieu autour de lui. Heath, en nageant, se positionne comme un observateur de la crise familiale. Il est littéralement dans le drame, mais sa nage calme et mesurée le sépare du tumulte émotionnel des autres personnages. Il a un regard lucide, voire ironique, sur les dilemmes d’Ellida et Edward, qu’il connaît intimement.
Au milieu d’une pièce intense, la nage de Heath offre un moment de calme et de contemplation. Pour le public, c’est une occasion de respirer et de réfléchir au sens des événements. Pour Heath, c’est une pause nécessaire, loin des cris et des décisions désespérées des autres. Il semble plus affecté par cela que par sa propre mort future. C’est peut-être la seule façon pour lui de traiter le chaos ambiant. Quoi qu’il en soit, sa situation tragique se reflète dans les ambitions frustrées des autres personnages et ajoute une couche de fatalisme au récit, renforçant l’idée que la mort plane sur la vie de tous…
Et on ne peut parler de cette pièce sans l’image finale, un plan final muet, violent, qui remplace le dialogue d’Ibsen par une image sensorielle. Dans cette dernière scène – que l’on ne sait évidemment pas être la dernière – Ellida (Alicia Vikander) est au bord de la piscine avec sa valise. Edward (Andrew Lincoln) tente de la retenir – ou simplement de la comprendre. Mais la tension monte, et dans un geste soudain, il tombe dans la piscine, sous les yeux d’Ellida, qui reste immobile. L’eau se referme sur lui. Noir. Fin.
Dans le texte original d’Ibsen, c’est Ellida qui décidait de revenir faisant le pari que cette fois elle serait libre dans son couple. Chez Stone, c’est le mari qui tombe. Le symbole est inversé. Chez Stone, l’homme se noie dans son propre besoin de contrôle. C’est donc le patriarche qui perd pied – littéralement. Edward chute, non parce qu’il est méchant ou coupable – il est fondamental de dire que cela n’est pas un sale type – mais parce qu’il ne comprend pas cette liberté qu’il vient pourtant d’accorder lui-même. Le geste devient une métaphore du désarroi masculin face à l’émancipation féminine.
Dans la pièce d’Ibsen, la libération d’Ellida rééquilibre le couple: le mari la rend libre, elle choisit de rester, l’ordre moral se restaure. Chez Stone, ce rééquilibre est impossible. La liberté d’Ellida ne sauve pas le mariage, elle le dissout. Edward, privé de son rôle de guide, s’effondre symboliquement. La piscine devient la tombe d’un modèle conjugal bourgeois lié au mariage. Mais rappelons qu’Ellida quitte plus le mariage avec Edward qu’Edward lui-même. On ne sait pas ce que deviendra leur relation.
En fait, ni l’un ni l’autre ne « choisit » vraiment, ils se perdent dans le même élément – celui de l’incertitude.
La fin n’indique pas si Ellida reviendra un jour ou si elle choisira de rejoindre Finn, son ancien amant. Comme le souligne une critique: «Qui sait dans la version ouverte de Stone…?» La fin d’Ellida se juxtapose à celle d’Edward, qui tombe dans la piscine. Lui est englouti par les circonstances et le chaos qu’il ne peut maîtriser, tandis qu’Ellida fait un choix proactif, ce qui renforce le contraste entre leur état mental et leur destin.